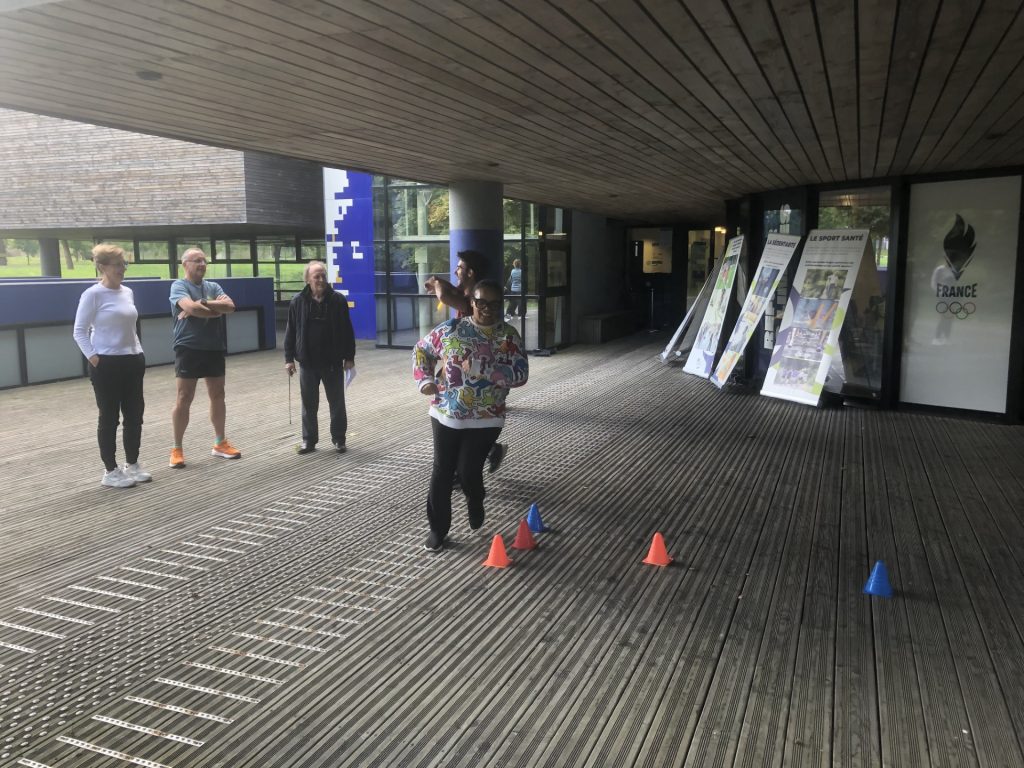Regards d’experte : Patricia Minaya-Flores, adjointe à la sous-directrice de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques (Direction générale de la santé, Ministère de la santé et de l’accès aux soins)
Que pensez-vous de l’évolution de la santé mentale ces dernières années ?
L’impact de l’épisode pandémique de la Covid-19 a mis en évidence l’importance de la santé mentale comme composante de la santé globale. En particulier, cette crise a marqué un tournant important avec une prise de conscience générale d’une détérioration de l’état de santé mentale des enfants et des jeunes.
Ainsi, les résultats de l’enquête nationale sur la santé et l’usage de substances des collégiens et lycéens (EnCLASS1 ) montrent que la santé mentale des collégiens et des lycéens s’est dégradée (surtout chez les filles2 ) entre 2018 et 2022. Si la plupart de ces adolescents se déclarent spontanément en bonne santé, il apparaît que seule la moitié des élèves participants présente un bon niveau de bien-être mental, avec un vécu de sentiment de solitude pour un quart d’entre eux et un risque important de dépression pour 14% des collégiens et 15% des lycéens, de plus, environ un lycéen sur dix a déclaré avoir fait une tentative de suicide au cours de sa vie.
11 % des personnes âgées de plus de 15 ans présentent ainsi un trouble dépressif en France,
les personnes âgées et les jeunes étant les plus concernés.
On constate de la même façon une augmentation des troubles dépressifs en population générale. Cette tendance, amorcée dès 2010, s’est accélérée entre 2017 et 2021, et est toujours à la hausse. 11 % des personnes âgées de plus de 15 ans présentent ainsi un trouble dépressif en France, les personnes âgées et les jeunes étant les plus concernés. Il s’agit de l’un des taux les plus élevés d’Europe, où le taux est de 6 % en moyenne3 . Les troubles psychiques sévères, comme les troubles schizophréniques et bipolaires, concernent chacun environ 1 % de la population.
Il est important de rappeler que la santé mentale est déterminée par des facteurs socioéconomiques, biologiques et environnementaux. Tout au long de notre vie, ces multiples déterminants peuvent se combiner pour protéger ou, au contraire, altérer notre santé mentale. Cela peut être le cas lorsqu’on est confronté à la violence, la pauvreté, la dégradation de l’environnement, etc. Des facteurs individuels biologiques, notamment génétiques, psychologiques, tels que la sensibilité émotionnelle, ou comportementaux comme la consommation de substances, peuvent par ailleurs rendre les gens plus vulnérables aux problèmes de santé mentale.
Inversement, des facteurs de protection nous préservent et augmentent notre résilience. Sur le plan individuel, il s’agit notamment des compétences psychosociales, qui sont des compétences cognitives, émotionnelles et relationnelles qu’il est possible de travailler pour les renforcer. On peut également citer les comportements favorables (avoir une bonne hygiène de sommeil, une activité physique…), ainsi que le fait d’évoluer dans un environnement positif, avec des interactions sociales satisfaisantes, un cadre de vie sûr, des activités -notamment professionnelles- épanouissantes.
Chaque facteur de risque ou de protection n’a qu’une force prédictive limitée. Ce sont les interactions entre les multiples déterminants qui renforcent ou compromettent la santé mentale. Pour agir positivement sur les déterminants de la santé mentale de la population, il est nécessaire de mobiliser diverses politiques publiques, de sorte à agir sur les conditions de vie des personnes comme le logement, la vie sociale et citoyenne, la lutte contre les inégalités et les discriminations, etc.

En quoi cette grande cause peut-elle avoir un impact dans ce domaine ?
La Grande Cause nationale sur la santé mentale est l’occasion d’une mise en lumière des enjeux de la santé mentale, tant sur le plan individuel que collectif. Elle permettra une meilleure information du public et une réflexion globale sur ce qui pourrait améliorer la santé mentale de la population. L’ensemble du Gouvernement a été ainsi invité par le Premier Ministre à faire des propositions en ce sens.
Le sport incarne tout à fait ce potentiel : il suppose des efforts, de l’entraînement, de l’adversité, voire des renoncements et des sacrifices. Il peut tout à la fois être source de souffrance, tant physique que psychique, et opportunité d’épanouissement. La Grande Cause nationale sur la santé mentale sera l’occasion de parler plus librement de ce qui fait souffrir ou satisfait, et des façons de prendre soin de soi et des autres. Les témoignages des sportifs sont à ce titre particulièrement précieux car ils mettent en évidence le fait que tout un chacun (même eux !) peut connaître des difficultés et être confronté à des troubles psychiques (anxiété, dépression, etc.), tout en soulignant que des solutions existent et qu’il est possible de se rétablir et d’aller mieux.
Les témoignages des sportifs sont à ce titre particulièrement précieux car ils mettent en évidence le fait que tout un chacun (même eux !) peut connaître des difficultés et être confronté à des troubles psychiques (anxiété, dépression, etc.), tout en soulignant que des solutions existent et qu’il est possible de se rétablir et d’aller mieux.
Comment le ministère de la Santé s’associe à la Grande Cause nationale ?
Le ministère de la Santé est chargé de la politique de santé mentale. Il a ainsi lancé en 2018 la feuille de route Santé mentale et psychiatrie qui prévoit différentes actions pour améliorer la promotion et la prévention, l’accès et le parcours de soins en psychiatrie, ainsi que l’inclusion et la participation des personnes en situation de handicap psychique. Cette feuille de route, dont un bilan est publié chaque année, a été enrichie d’autres mesures suite aux Assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues en septembre 2021.
En conseil des ministres le 19 mars 2025, Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, et Monsieur Yannick Neuder, ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins, ont présenté une communication relative à la santé mentale, lançant ainsi la grande cause nationale pour 2025 précédemment annoncée par le Premier Ministre lors de sa déclaration de politique générale. Dans le cadre de cette mobilisation interministérielle autour de la santé mentale, le ministère de la Santé a été invité comme les autres à proposer de nouvelles actions pour approfondir l’action publique sur cette thématique. Ces propositions alimenteront une stratégie nationale de prévention et d’accompagnement qui sera discutée puis présentée lors d’un comité interministériel qui se tiendra en juin 2025.
Divers événements et campagnes de communication vont ponctuer cette année pour mettre en valeur différents enjeux : la nécessaire prise de conscience collective que nous avons toutes et tous une santé mentale et des moyens pour l’améliorer, la santé mentale au travail, la santé mentale des jeunes et le soutien à la parentalité, la santé et les vulnérabilités, qu’elles soient liées à l’âge, à l’état de santé ou à une situation économique défavorable, ces sujets étant étroitement intriqués.
Comment le sport peut-il jouer un rôle ? Quels sont les bienfaits pour la santé mentale ?
En plus des bénéfices sur la santé physique, notamment en luttant contre les effets de la sédentarité, une activité physique régulière contribue à une meilleure santé mentale pour toutes les personnes et à tout âge.
Pour les personnes vivant avec des troubles psychiatriques comme les troubles schizophréniques ou la dépression, la HAS a produit en 2022 des fiches avec des conseils sur l’activité physique4. En effet, en complément de l’accompagnement médical, la pratique régulière d’une activité physique peut réduire les symptômes tels que les délires, les hallucinations, la perte de plaisir, le manque de désir et de motivation. De plus, l’activité physique régulière réduit les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, souvent associés aux troubles psychiatriques, et qui peuvent impacter l’espérance de vie.
L’activité physique améliore aussi les symptômes d’anxiété et la qualité du sommeil, et favorise la vie sociale qui est un important facteur de protection de la santé mentale. En effet, pratiquer une activité physique et sportive avec des collègues, des amis, en famille, ou encore, au sein d’un club, aide à renforcer le sentiment d’appartenance à un groupe et favorise l’intégration sociale. Cet effet bénéfique a un intérêt certain pour lutter contre l’isolement, particulièrement chez les personnes âgées et les personnes en recherche d’emploi.
Selon vous, les clubs sportifs doivent-ils être des acteurs engagés sur ce sujet ?
Oui, les clubs sportifs ont un rôle important à jouer tant comme relai d’information sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé mentale, que comme vecteur de transmission de valeurs individuelles et collectives, et comme lieu de sociabilité favorisant l’inclusion de tous.
Oui, les clubs sportifs ont un rôle important à jouer tant comme relai d’information sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé mentale, que comme vecteur de transmission de valeurs individuelles et collectives, et comme lieu de sociabilité favorisant l’inclusion de tous.
Sur le plan individuel, l’activité sportive permet de mieux réguler son stress et ses émotions. Elle permet aussi d’exercer ses fonctions cognitives, en élaborant des stratégies pour surmonter les difficultés et optimiser la performance. Sur le plan collectif, le milieu sportif transmet des valeurs de tolérance, de compréhension et d’acceptation mutuelle. Le sport pratiqué dans un environnement bienveillant permet ainsi de renforcer ses compétences psychosociales (émotionnelles, cognitives, relationnelles). C’est ainsi que le ministère chargé des Sports est partie prenante de la stratégie nationale de développement des compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes co-pilotée par les ministères chargés de la Santé et de l’Education nationale. L’objectif est de faire bénéficier ce public d’interventions tout au long de son développement, à l’école, mais aussi dans le cadre des loisirs. Les clubs sportifs ont la possibilité de s’engager dans cette démarche, en formant leurs intervenants. Des informations sont disponibles auprès des agences régionales de santé.
Bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans sa performance !
1 – Menée auprès de 9 337 élèves du secondaire par l’École des hautes études en santé publique (EHESP) et l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), en partenariat avec l’Education nationale
2 – Un quart des lycéens interrogés (24%) a déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, les filles étant nettement plus concernées que les garçons (31% vs 17%).
3 – DREES, Etudes et résultats n°1324, janvier 2025.
4 – Haute Autorité de santé, L’activité physique, votre meilleure alliée santé, documents usagers, décembre 2022.
D’autres articles pourraient vous intéresser :
[Initiatives de clubs] La JSA d’Allonnes mise en lumière dans un podcast sport-santé et inclusion
La JSA d’Allonnes Omnisports a récemment été invitée à participer à un podcast consacré à…
Formation « 1000 clubs pour le sport et la santé » _ 2026
La Fédération Française des Clubs Omnisports ouvre une nouvelle session de formation « 1000 clubs pour…
Journée de rassemblement des éducateurs sport santé IDF
Le mardi 14 octobre s’est tenu la première édition de la journée de rassemblement des…